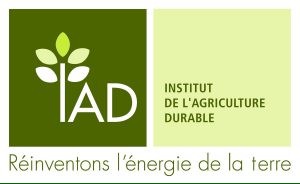La conception d’un projet à vocation économique
Le défi de la souveraineté alimentaire au Sénégal est immense. Nos politiques agricoles passées, malgré des financements massifs, n’ont pas généré de réelles viabilités économique ni créé d’emplois formels durables. Pourquoi ? Parce que la conception des projets agricoles publics comporte un biais majeur : elle est inadaptée aux réalités du marché.
Alors que la conception d’un projet à vocation économique devrait suivre une stratégie robuste et des étapes précises :
- Étude de marché
- Étude de faisabilité
- Avant-Projet-Détaillé
- Étude d’impact environnemental et social
- Recrutement de l’équipe de mise en œuvre du projet
- Cahiers des charges et dossiers d’appels d’offres
- Exécution du projet
- Suivi-Évaluation
La grande majorité des projets agricoles publics sont exécutés selon une procédure codifiée adaptée à l’exécution d’infrastructures (routes, énergie, l’eau et l’assainissement, ports …). Cette approche présente des lacunes critiques :
- Elle ne prévoit pas d’étude de marché, car il n’y a pas de concurrence directe pour une route ou une ligne électrique.
- L’étude de faisabilité se concentre sur la topographie et l’expropriation foncière, ignorant les coûts de production et la concurrence d’un marché ouvert.
- Les équipes recrutées par les bailleurs de fonds et les services publics sont compétentes en finances publiques, procédures environnementales et sociales, et infrastructures, mais très rarement gestion d’entreprises, stratégie commerciale, agronomie, industrie ou contrôle de gestion. Leur mission se limite souvent à la bonne exécution d’un budget et au respect des normes, peu importe la viabilité économique.
C’est là que réside le problème fondamental : Le produit alimentaire développé est-il compétitif dans un marché ouvert ?
Les bailleurs de fonds et les agences gouvernementales sénégalaises disposent encore d’une marge de progression importante pour renforcer leurs compétences en conception de projets agricoles. L’élément central doit-être l’analyse des contraintes et des atouts économiques.
Par exemple, la filière riz, malgré des aménagements hydroagricoles rétrocédés gratuitement aux paysans, n’a jamais été économiquement viable au Sénégal. Le maintien d’un prix bas de 350 FCFA/kg pour les brisures, comparé aux 450 FCFA/kg en Mauritanie ou 600 FCFA/kg au Nigeria pour le riz local, rend la situation intenable pour les producteurs et rizeries. La priorité implicite de la politique alimentaire depuis l’indépendance est de garantir des brisures à bas prix pour éviter les tensions sociales dans les villes, peu importe qu’elles soient produites localement ou importées.
Les conséquences de cette approche sont lourdes et récurrentes :
- Projets rarement viables sur le plan économique (arachide, riz, céréales locales).
- Caractère plus social (survie rurale) qu’économique (création de richesse et d’emplois formels).
- Une partie des aménagements implantés sur des sites inondables, inaccessibles en hivernage ou détruits par les crues décennales.
- Gouffres financiers, avec des charges d’études, de contrôles et de personnel d’exécution pouvant engloutir jusqu’à 50 % du financement.
- Très peu pourvoyeurs d’emplois par unité de financement.
- Fort impact environnemental, notamment en termes de consommation d’eau pour la riziculture.
Des exemples de projets d’infrastructures agricoles peu efficients abondent, tels que les aménagements rizicoles de la vallée et de l’Anambé, le PDMAS, le PDIDAS, l’ANIDA, l’Agropole de Mpal, le réseau SIPA ou le PRODAC. Le Sénégal a contracté des prêts se chiffrant en centaines de milliards de FCFA pour financer ces programmes. Sénégalaises et Sénégalais, vous remboursez ces prêts sur 20 à 40 ans ! Sachez que ces projets ne permettent ni aux bénéficiaires de vivre correctement, ni de créer des emplois dans le secteur formel. Ils n’affichent aucun résultat économique notable.
Les programmes agricoles au Sénégal : des ajustements nécessaires
La Vision Sénégal 2050 a fixé des objectifs ambitieux pour le pays :
- Tripler le PIB par habitant et réduire le taux de pauvreté à 10 % d’ici à 2050.
- Atteindre une croissance économique moyenne de 6,5 % par an entre 2025 et 2029.
- Faire du Sénégal un pays industrialisé, compétitif et résilient, intégré dans les chaînes de valeur mondiales.
Cependant, la vision du secteur agricole a fluctué ces 20 dernières années. Après une approche axée sur la sécurité alimentaire et l’autosuffisance (GOANA en 2008, impact faible sur la productivité), le Plan Sénégal Émergent (PSE) visait à faire de l’agriculture un levier de croissance (PNAR, PRACAS). Ces programmes n’ont apporté aucune solution crédible aux problématiques économiques des filières. La riziculture n’est toujours pas rentable et les producteurs de légumes subissent toujours des prix bas à cause de la surproduction saisonnière.
L’inefficacité de ces programmes successifs a la même origine : ils incitent à produire toujours plus, sans se soucier des débouchés et de la concurrence des autres origines. L’analyse simpliste selon laquelle « le pays n’est pas autosuffisant, donc le marché existe » est totalement erronée. Tant que le consommateur veut de la brisure de riz alors que la filière locale a besoin de vendre du riz entier départ usine à 450 FCFA/kg pour être viable, peu importe les aides publiques, producteurs et rizeries feront faillite.
Le projet des Agropoles du Sénégal : Un espoir ou une récidive ?
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, pilote le projet des Agropoles du Sénégal. Ses promoteurs affirment qu’il vise à structurer le développement agro-industriel, à renforcer la valeur ajoutée, à réduire la dépendance aux importations et à promouvoir une industrialisation durable.
Les principaux objectifs des 5 Agropoles régionales sont :
- Améliorer la compétitivité économique et la résilience face au changement climatique.
- Soutenir la souveraineté alimentaire et réduire le déficit commercial.
- Créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes, notamment en milieu rural.
- Favoriser l’équité territoriale par un développement industriel réparti dans toutes les régions.
Chaque Agropole est conçue comme un hub agro-industriel et logistique, avec des infrastructures, des services et des savoir-faire mutualisés, ciblant selon ses auteurs des filières à fort potentiel (ex : mangue, anacarde, arachide, céréales pour l’Agropole Centre).
Le Projet de Zone de Transformation Agro-Industrielle du Nord (PZTA-Nord) illustre cette ambition, avec un budget conséquent de 283 millions de dollars (environ 185 milliards de FCFA. Le projet cible des filières comme les céréales (riz, maïs, blé), l’horticulture (oignon, patate douce, tomate…), les produits animaux et de la pêche/aquaculture.
Le PZTA-Nord est structuré en trois composantes :
- Renforcement des capacités de transformation agro-industrielle et de mise en marché.
- Accroissement durable de la productivité et de la production des filières agro-industrielles.
- Coordination, gestion et suivi-évaluation.
La projet prévoit la création de trois Parcs Agro-Industriels (PAI) à Bokhol (Dagana), Dahra (Linguère) et Ogo (Matam). Ces PAI de 130 à 150 ha serviront de plateformes multifilières, intégrant transformation, stockage et distribution. Le PAI de Bokhol, inclut la viabilisation complète du site (rues, électricité, eau, assainissement, énergie solaire/biogaz) ainsi que des unités agro-industrielles, de services, des bâtiments de stockage, de maintenance, et même… un centre de santé, des écoles et une crèche. En complément, 14 Centres d’Appui Secondaire (CAS) seront établis localement, et la plateforme de Mpal sera réhabilitée en CAS.
Critique du projet de l’Agropole Nord : les mêmes erreurs répétées ?
D’emblée, les informations disponibles en mai 2025 suggèrent que la conception de ce projet suit la même méthodologie inadaptée appliquée aux projets d’infrastructures depuis des décennies. Il est donc probable que l’Agropole Nord ne dérogera pas aux écueils des projets précédents.
Prenons l’exemple du site de Bokhol pour étayer ce point :
- Manque d’information des acteurs locaux : L’étude d’impact environnemental et social (EIES) révèle que la plupart des agents publics interrogés n’ont pas d’informations claires sur les objectifs et réalisations du projet.
- Absence de logique dans le choix du site : Il n’y a pas de méthodologie affichée pour la localisation des sites ou le choix des infrastructures. Le choix de Bokhol est un mystère.
- Potentiel de production ? À l’évidence, non. Moins de 6 000 ha d’aménagements hydroagricoles sont présents dans un rayon de 20 km. Des communes en amont ou en aval présentent des potentiels agricoles bien plus élevés.
- Proximité des marchés ? Pas plus. Moins de 25 000 habitants résident à Bokhol.
- Affirmations erronées sur les infrastructures existantes : L’étude mentionne un manque d’infrastructures de stockage et de transformation du riz paddy. C’est faux. Il existe plus de 30 rizeries opérationnelles dans la vallée. Plusieurs disposent de capacités de stockage de paddy non utilisées (15 000 t à la CASL, 5 000 t chez VITAL). Pour la plupart, les capacités d’usinage sont utilisées à moins de 50 % de leur capacité (ex : la CASL, capable de traiter 50 000 t par an, utilisée à moins de 20 % depuis 2020). La raison : le manque de production dû à l’absence de rentabilité de la filière.
- Estimations d’emplois irréalistes et peu sérieuses : La création de 32 740 emplois est annoncée, mais la description des postes créés est conditionnelle (déchargement, gardiennage, entretien). Ceci démontre que les auteurs de l’étude n’ont pas une idée précise des activités à développer sur le site.
- Infrastructures prévues non pertinentes ou incohérentes :
- Quel est l’intérêt d’implanter une unité énergétique solaire à Bokhol alors qu’une centrale photovoltaïque de 20 MW existe déjà sur la commune ?
- Des installations à caractère social comme un centre de santé, des écoles ou une crèche n’ont pas leur place dans une zone agro-industrielle classée ICPE. La cohabitation avec le transport de milliers de tonnes de produits agricoles est totalement incompatible.
En bref, l’étude d’impact environnemental et social a visiblement été réalisée sans se baser sur une étude de marché ni sur une étude de faisabilité solide. L’Évaluation de projet par la Banque Africaine de Développement ne fait référence à aucune source vérifiable. Les hypothèses et les analyses conduisant à caractériser le projet sont inconnues.
À ce stade, à la lecture des documents publics, aucune stratégie économique robuste n’est présente dans ce projet d’Agropole Nord.
Quelle méthodologie pour concevoir un projet agricole ?
Fort d’une expérience de plus de 35 ans dans la conception de projets de développement rural, d’exploitations agricoles, de projets agro-industriels et environnementaux, et d’accompagnement de producteurs en Afrique de l’Ouest, je pense avoir une certaine légitimité pour apporter une réponse à cette question.
Tout projet agricole à vocation économique devrait débuter par une étude de marché par filière. Cette étude doit analyser la concurrence, les opportunités économiques et les faiblesses structurelles de la filière.
Pour la filière oignon, par exemple, il convient :
- De consulter les données statistiques, les exportateurs, importateurs, grossistes, la grande distribution, les transitaires et les ports du Sénégal et des pays exportateurs/importateurs (Nigeria, Côte d’Ivoire, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne).
- De comparer mois par mois les volumes et les niveaux de prix de la production, des importations, des exportations et de la consommation. Sans cette étude, il est impossible de définir une vision stratégique.
L’étude de faisabilité doit ensuite identifier les contraintes technico-économiques pour déterminer le niveau de compétitivité des productions, mois par mois. Tous les facteurs limitants pour conquérir les marchés doivent être identifiés, avec des objectifs clairs en termes de couts, de qualité du produit et de services. Des actions concrètes (investissements, formation, organisation de producteurs, fiscalité, subventions, labels) doivent être définies pour satisfaire les clients et les consommateurs.
Cette étude de faisabilité doit être coconstruite avec les acteurs de la filière :
- Au niveau de la production : organisations de producteurs, centres de recherche nationaux et internationaux, centres de gestion (CGR-Vallée).
- En amont : semenciers, agrofourniture et concessionnaires de matériel agricole.
- En aval : centre de stockage, usine SAF, grossistes et consommateurs.
L’étude doit définir les axes stratégiques et répondre a minima aux questions suivantes :
- Produire pour le marché local ou pour l’exportation ? Comparaison économique des deux options.
- Définir le produit pour le marché visé : variétés, calibres, conditionnements, quantité, période de production.
- Quels sont les marges à la production en fonction du rendement/ha et des autres acteurs de la filière (usine, transporteur, grossiste, détaillant) ?
- Quelles évolutions prévoir au niveau de la production, du conditionnement ou de la transformation et de la distribution pour satisfaire ce marché ?
- Quelles contraintes (agronomique, stockage, logistique, formation, réglementaire, économique) faut-il lever ?
- Si le marché identifié est rentable pour les producteurs, sur quels points bloquants l’État doit intervenir ?
Il convient ensuite de sélectionner la zone de production la plus compétitive. Le choix du site doit tenir compte des conditions climatiques pour une production précoce et tardive pour assurer un étalement de la période de commercialisation. D’autres critères de sélection sont à prendre en compte et notamment la texture et la topographie des sols, l’accès à une source d’eau durable, la présence d’infrastructures existantes (routes, électricité) et la disponibilité de main-d’œuvre et des prestataires de services qualifiés. Les infrastructures à réaliser devront lever les contraintes identifiées.
L’étape suivante est l’Avant Projet Détaillé de chaque infrastructure, incluant des scénarios de rentabilité. Par exemple, une infrastructure de stockage d’oignon pourrait être adaptée à la patate douce, optimisant l’occupation des bâtiments et la période de travail des employés.
Ce n’est qu’à l’étape suivante que l’EIES sera réalisée. À ce stade, la vision stratégique est clairement définie et partagée par tous les acteurs, et la méthodologie de définition des infrastructures répond à un objectif de performance économique. Les principaux acteurs économiques sont ainsi au cœur du processus de décision.
Des modèles inspirants : les politiques agricoles du Maroc et de la Mauritanie
L’agriculture marocaine est souvent citée comme un exemple en Afrique. Le Maroc est un pays qui a profondément transformé son secteur agricole depuis les années 1980 :
- 1980 – 2000 – Libéralisation et ajustement structurel.
- Encouragement du secteur privé, modernisation partielle de l’agriculture commerciale.
- Développement des filières compétitives (agrumes, primeurs) grâce à la libéralisation des marchés.
- Transfert de technologie et partenariats avec la France, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Espagne (irrigation, serres, semences hybrides).
- Introduction de technologies et d’intrants modernes par des multinationales (Netafim, Bayer, Syngenta).
- Développement d’une agriculture intensive dans certaines zones (Gharb, Haouz, Souss) avec des investissements massifs dans l’irrigation (goutte-à-goutte, aspersion).
Ces étapes ont posé les bases d’une production significative de fruits et légumes pour le marché national et l’exportation vers l’Europe, créant de la valeur ajoutée et des emplois formels. La principale critique est la marginalisation de l’agriculture vivrière familiale.
- 2008 – 2020 : Plan Maroc Vert (PMV)
- Objectifs : Doubler la valeur ajoutée agricole et créer 1,5 million d’emplois.
- Deux piliers : Soutien à l’agriculture intensive et moderne (Pilier I), appui à l’agriculture solidaire dans les zones fragiles (Pilier II).
- Résultats : Forte croissance des exportations agricoles et amélioration de la productivité.
- Critiques : Inégalités persistantes, faibles retombées pour les petits exploitants, pressions sur l’eau.
- Depuis 2020 : Stratégie « Génération Green 2020–2030 »
- Objectifs : Valoriser le capital humain agricole, créer 350 000 emplois, émergence d’une nouvelle classe moyenne rurale, généralisation de la couverture sociale, et durabilité (meilleure gestion de l’eau)
- Enjeux : Renforcer la résilience climatique, mieux intégrer les petits exploitants, concilier productivité, équité et durabilité
Exemple d’un projet agricole au Maroc : Le périmètre de Massa
Dès les années 80, le Maroc a défini une vision claire : une agriculture commerciale compétitive, orientée vers les marchés extérieurs solvables (européens). Toutes les ressources ont été mobilisées pour atteindre cet objectif unique. Le périmètre de Massa, au sud d’Agadir, est un exemple éloquent :
- Sur 18 000 ha, création d’un réseau d’irrigation sous pression avec stations de pompage et canalisations.
- Une répartition foncière organisée a permis d’accueillir des exploitations modernes (grands exploitants marocains, investisseurs privés, coopératives).
- Le périmètre est quadrillé de routes goudronnées, délimitant des blocs de 50 ha avec accès à l’eau. Les parcelles attribuées sont de 25 ha.
- De nombreuses mesures d’accompagnement économiques et institutionnelles ont permis aux entreprises de développer les productions sous serre, destinées à l’exportation :
- Construction d’Agropoles à proximité du périmètre irrigué pour les stations de conditionnement, d’expérimentation agronomique, l’agrofourniture, etc…
- Accès facilité au port d’Agadir et développement de la logistique aérienne.
- Amélioration du réseau routier.
- Crédits agricoles bonifiés (CNCA), subventions à l’irrigation localisée, et soutien à l’exportation (exonérations douanières).
- Renforcement de la vulgarisation agricole et introduction de techniques modernes (fertigation, serres, lutte intégrée) via la coopération étrangère.
- Structuration des filières exportatrices via des interprofessions.
Résultat : La plaine du Souss-Massa est devenue un pôle majeur, contribuant à plus de 40 % de la production nationale d’agrumes et à plus de 60 % des primeurs.
Périmètre irrigué du Souss-Massa

Exemple de projet en Mauritanie : L’essor de l’horticulture à Aftout Essahli
La politique agricole mauritanienne vise également à développer les productions de fruits et légumes pour le marché national et destinées à l’exportation vers l’Europe.
- Le canal d’irrigation Aftout Essahli (70 km, autofinancé, mis en service en 2017) est une infrastructure clé, située à 150 km au sud de Nouakchott, bénéficiant d’un climat océanique idéal.
- La filière pastèque s’est fortement développée depuis 2022, portée par des investisseurs marocains. En 2023, 18 000 t de pastèques ont été exportées vers l’Europe (16 millions d’euros de CA), faisant de la Mauritanie le premier fournisseur de l’UE devant le Costa Rica, le Maroc et le Sénégal.
- D’autres cultures (tomate, poivron sous serres) se développent, portant la surface maraîchère à 1 200 ha en 2025.
- Cette horticulture a créé environ 1 000 emplois équivalent temps plein et 3 fois plus d’emplois indirects.
- La Mauritanie a également autofinancé la construction du port N’Diago (2016-2025) pour améliorer la compétitivité à l’export. Le coût du transport par camion vers Perpignan (France) devrait passer de 9 500 à moins de 7 000 euros par container. Pour la pastèque, cela représente un gain de marge de 7 %, faisant passer la marge nette du producteur de 15 % à 22 % !
- Une route est prévue pour connecter le canal au port et aux grands axes routiers. Le partenariat maroco-mauritanien s’étend aussi à la pêche et à l’aquaculture.
Ce développement agricole en Mauritanie s’est fait sur la seule volonté du gouvernement mauritanien, sans l’appui des institutions internationales. Cette frilosité s’explique par les craintes réputationnelles liées au lobbying d’ONG environnementales (Wetlands International, IUCN, BirdLife International) qui expriment des préoccupations sur les impacts de ces infrastructures sur la biodiversité du Parc National du Diawling. Cependant, il n’est pas raisonnable de s’opposer à la volonté légitime de la Mauritanie de mettre en valeur son seul bassin de production significatif. L’Europe gère bien la cohabitation entre activités agricoles et protection de la nature (ex : rizières de Camargue) ; pourquoi pas en Afrique ?
Quel projet agricole d’envergure pour le Nord du Sénégal ? Une immense opportunité
La politique agricole du Sénégal doit en priorité répondre à l’objectif économique de la Vision Sénégal 2050, qui vise une croissance économique annuelle de 6,5 %.
La riziculture sur 71 000 ha par an, la première production de la vallée, a un intérêt économique limité :
- Chiffre d’affaires moyen faible (740 000 FCFA/ha pour le producteur, 1,2 MFCFA/ha pour le rizier).
- Marge nette inférieure à 5 % pour l’ensemble des acteurs.
- Aménagement des rizières subventionné à hauteur de 3 à 7 MFCFA/ha.
- Création d’emplois informels limitée (30 jour-homme /ha).
- Consommation d’eau très élevée (16 000 à 19 000 m3/ha par submersion).
- Problème de santé publique majeur : consommation importante de riz blanc (88 kg/habitant) liée à plus de 20 maladies métaboliques (diabète, AVC, crise cardiaque, hypertension…).
Par conséquent, la promotion de la riziculture est un non-sens économique, social, environnemental et sanitaire.
À l’inverse, la promotion des cultures légumières et fruitières, notamment pour l’exportation vers l’Europe, devrait être une priorité pour le Nord du Sénégal. L’intérêt économique est évident :
- Pour le haricot-vert, le maïs doux, la patate douce et l’oignon doux, le chiffre d’affaires moyen est de 17 millions de FCFA/ha et la marge nette de l’ordre de 20 %.
- L’investissement pour un système d’irrigation par aspersion ou goutte-à-goutte est de 3 à 5 millions de FCFA/ha.
- La création d’emplois formels est de 300 à 400 jour-homme /ha.
- La consommation d’eau est de seulement 5 000 à 7 000 m3/ha.
- Les écarts de triage permettent d’alimenter le marché national en fruits et légumes à bas prix.
La promotion des fruits et légumes pour le marché local et sous-régional est aussi pertinente, à condition de choisir une stratégie de production précoce et tardive pour bénéficier de prix rémunérateurs. Une production d’oignon commercialisée en mars peut générer 11 millions de FCFA de chiffre d’affaires et 40 % de marge, contre 7 millions de FCFA et 5 % de marge en avril. La création d’emplois est d’environ 300 jour-homme /ha.
Culture d’oignon

Il est évident que le développement des cultures légumières et fruitières constitue une immense opportunité économique :
- Comparé à la riziculture, un hectare de légumes génère 12 fois plus de chiffres d’affaires, 50 fois plus de bénéfices et 10 fois plus d’emplois.
- L’investissement en système d’irrigation est équivalent ou inférieur.
- Le prélèvement sur la ressource en eau est 3 fois inférieur.
- La promotion de ces produits contribue grandement à la santé publique.
Les exemples du Maroc et de la Mauritanie doivent montrer la voie au Sénégal. Le Sénégal a un avantage compétitif sur le Maroc concernant le coût de la main-d’œuvre (3 000 FCFA/jour vs 7 080 FCFA/jour) et dispose d’une ressource en eau suffisante, sous réserve de la réalisation des barrages de Gourbassi et Koujoutamba. Le climat tropical du Sénégal permet une production de fin décembre à fin avril de légumes qui ne peuvent être produits dans la région d’Agadir à cette période.
Cependant, le coût du fret est le principal désavantage compétitif du Sénégal. Le fret par semi-remorque frigorifique vers Perpignan est de 9 500 à 10 000 € contre 5 000 € pour Agadir.
De nombreuses entreprises marocaines et espagnoles prospectent au Sénégal pour développer des productions légumières, apportant capitaux et expertise. Mais peu de sites répondent aux critères requis pour la réussite de leurs projets : un climat océanique (à moins de 25/30 km de l’océan), une source d’eau et des sols disponibles et non salés, un terrain non accidenté et accessible. Ce manque de sites adaptés est une perte de création de richesse pour le pays.
L’Agropole de Mpal et Fas Ngom, construite en 2005 (3 milliards FCFA), est la plus grande station de conditionnement de fruits et légumes du Sénégal (plus de 7 000 m², capacité de 50 000 t/an). Pourtant, elle est inexploitée ou sous-utilisée à moins de 10 % de sa potentialité depuis sa mise en service. La raison principale est l’éloignement des zones de production (40 km pour la zone des 3 marigots et Potou). D’autre part, les légumes destinés au marché local sont rarement triés, conditionnés et refroidis en raison du coût et de l’absence de chaîne du froid chez les grossistes/détaillants.
Une solution d’envergure se trouve à portée de main : Une vaste plaine de plus de 12 000 ha de terre arable s’étend entre l’Agropole de Mpal et les 3 marigots. Idéalement située (20-35 km de l’océan, 10 km de la future autoroute), cette plaine pourrait accueillir un périmètre irrigué d’au moins 10 000 ha. La source d’eau serait le fleuve Sénégal via un réseau de canalisations, desservant des exploitations de 50 ha.
Cette infrastructure, financée sur fonds publics, permettrait de produire en saison fraîche environ 500 000 t de fruits et légumes pour l’exportation et le marché local, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 130 milliards de FCFA et plus de 10 000 emplois formels directs. En hivernage, elle pourrait produire plus de 100 000 t de céréales et d’oléagineux pour l’alimentation du bétail, ainsi que des dizaines de milliers de tonnes de semences d’arachide.
Comme le montre le tableau suivant, ce seul projet permettrait de générer 1,5 fois plus de chiffres d’affaires que l’ensemble des aménagements hydroagricoles réalisés dans la vallée depuis 40 ans !
Comparaison des performances économiques de 2 filières
| Production | Surface aménagée |
Coût d’aménagement |
Surface cultivée par an |
Chiffre d’affaires par an |
|---|---|---|---|---|
| Riz | 60 000 ha | 300 milliards FCFA | 71 000 ha | 85 milliards FCFA |
| Légumes | 10 000 ha | 80 milliards FCFA | 20 000 ha | 130 milliards FCFA |
Plan de situation proposé pour un périmètre irrigué à Mpal Fas Ngom

Les marchés accessibles : l’oignon et la pomme de terre, des opportunités à saisir
Le Sénégal a exporté 113 000 t de légumes frais et 18 000 t de mangues en 2024, une quantité très faible comparé aux 429 000 t importées. L’oignon et la pomme de terre sont faciles à maîtriser agronomiquement, peu exposés aux maladies, faciles à conditionner et à exporter par fret maritime. Le projet de périmètre irrigué de Mpal et Fas Ngom pourrait développer une filière d’exportation solide autour de ces deux productions.
Oignon
L’UE importe plus de 330 000 t d’oignon (140 milliards FCFA). L’origine Sénégal ne représente que 4 % de ces importations. Il y a un marché de plus de 150 000 t à concurrencer (incluant le Royaume-Uni), notamment face aux origines d’Amérique latine, d’Océanie et d’Asie.
| Origine | Valeur (millions €) |
Quantité (tonnes) |
Valeur (€/kg) |
Valeur (FCFA/kg) |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 8,2 | 10 500 | 0,78 | 512 | Oignon jaune |
| Chili | 12,1 | 15 800 | 0,77 | 502 | |
| Chine | 8,1 | 13 800 | 0,59 | 385 | |
| Egypte | 62,0 | 95 000 | 0,65 | 428 | Oignon jaune, oignon de printemps |
| Inde | 3,7 | 3 400 | 1,09 | 714 | |
| Maroc | 12,2 | 8 000 | 1,53 | 1000 | Oignon jaune, oignon de printemps |
| Mexique | 5,0 | 4 500 | 1,11 | 729 | |
| Nouvelle Zélande | 31,5 | 40 600 | 0,78 | 509 | Oignon jaune |
| Pérou | 29,5 | 50 000 | 0,59 | 387 | Oignon doux Espagne |
| Sénégal | 8,8 | 12 800 | 0,69 | 451 | |
| Total | 213,4 | 333 800 | 0,64 | 419 |
Le semis direct et la plantation de bulbilles dans le nord du Sénégal peuvent permettre de produire au moins 35 000 t d’oignon supplémentaires en février et mars pour le marché national, en substitution aux importations.
Pomme de terre
Il existe un marché pour la pomme de terre surgelée en Afrique de l’Ouest, notamment au Nigeria. Une unité de transformation pourrait absorber la surproduction nationale d’avril à juin si des marchés d’exportation sont développés.
Importation de pomme de terre surgelée par les pays de la CEDEAO en 2023
Autres produits
Des opportunités commerciales existent en Europe et au Royaume-Uni pour d’autres produits comme le haricot-vert, le maïs doux, le melon, l’oignon de printemps en botte, la pastèque ou la patate douce. Ces produits nécessitent cependant une très bonne expertise agronomique. Ils sont réservés aux entrepreneurs les plus expérimentés.

Facteurs de réussite : L’expertise au cœur du développement
Au Sénégal, le facteur le plus limitant est de loin le manque d’expertise technique pour la conception de projets publics performants. Un projet agricole n’est pas un projet d’infrastructure classique. Il s’agit d’investir dans un outil productif et performant qui génère une plus-value. Les notions de marchés, de rendements, de maitrise des couts de production, de formation du personnel, d’accès à des garanties pour le financement des producteurs, de marges et de retour sur investissement (ROI) sont déterminantes. La recherche d’un avantage compétitif de la filière est au cœur de la réussite économique. Un franc investi doit générer plusieurs francs, voire des dizaines de francs de valeur ajoutée.
Les bureaux d’études et le personnel de management d’un projet agricole doivent intégrer cet objectif économique et avoir les savoir-faire nécessaires pour le mener à bien.
La problématique est similaire pour les producteurs, véritables chefs d’entreprise du secteur formel. Ils doivent impérativement disposer d’une formation en agronomie, en management et en gestion d’entreprise agricole. Dans la plupart des pays agricoles, un niveau minimum (BAC agricole) est exigé. La formation doit être spécifique et ciblée (phytotechnie, biologie végétale, usage des produits phytosanitaires, science agroécologie, maintenance du matériel, irrigation, gestion du personnel, traçabilité, comptabilité analytique).
Après son diplôme, un candidat à l’installation doit réaliser une étude d’installation (étude de marché, plan opérationnel et plan d’affaires). Les hypothèses de l’étude doivent être confirmées au cous d’un stage pratique d’au moins 3 mois chez un producteur. L’adhésion à un conseil agricole et à un centre de gestion agréé devrait être obligatoire. Cet accompagnement peut aussi être réalisé via des coopératives ou des usines avec des contrats de production.
Conclusion
Actuellement, trop peu de producteurs nationaux sont en mesure d’exporter vers l’Europe. L’accès à ces marchés exige une entreprise formelle et une excellente maîtrise agronomique et de la chaîne du froid. Un solide système d’informations est également indispensable pour respecter les normes de certification imposées par la grande distribution (GlobalGAP, BRCGS), pour planifier la production et pour disposer d’une comptabilité analytique.
À l’image de l’exemple marocain, le transfert de technologie ne peut se faire que par la présence d’entreprises marocaines et européennes. Disposer d’un grand périmètre irrigué destiné aux productions horticoles permettrait sur un même site ce transfert de technologie entre entreprises étrangères et nationales. L’ISRA, l’UGB, les semenciers et un groupement de producteurs pourraient disposer d’une ferme expérimentale, facilitant les échanges entre les chercheurs et les entreprises. Cela faciliterait aussi l’implication de tous les acteurs de la filière, de l’amont (banques, agrofournitures, matériel agricole, conseillers) à l’aval (conditionnement, transformation, stockage).
Ce périmètre irrigué pourrait servir de vitrine d’une agriculture moderne pour l’ensemble du Sénégal.
Un investissement d’environ de 80 milliards de FCFA permettrait de générer à l’horizon 5 ans un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 150 milliards de FCFA. Les taxes locales, les impôts sur les salaires, les revenus et les sociétés pourraient permettre à l’État de récupérer environ 5 milliards de FCFA par an.
Si ce projet est bien exécuté, cela pourrait être le premier projet agricole public rentable réalisé au Sénégal.
Ce modèle peut être reproduit dans d’autres régions du Sénégal. Pour la moyenne vallée, après études technico-économiques, des cultures tropicales comme la mangue, la datte et les agrumes pourraient être envisagées sur les sols sablo-argileux de Fondé. Sur les sols sableux de Diéri, la patate douce et la pastèque, complétées par des fourrages en hivernage, pourraient être associées à l’agroforesterie.
Á l’heure de la présentation du plan national de redressement économique, il ne serait pas inutile de prendre le temps de revoir la méthodologie de conception des politiques agricoles en œuvre depuis des décennies. Cela permettrait enfin de concevoir des investissements permettant d’assurer le décollage économique du secteur primaire. Cela éviterait aussi de créer à l’avenir de nouveaux déficits publics improductifs.